"Corporate Governance matters " : un ouvrage essentiel pour comprendre la gouvernance d'entreprise
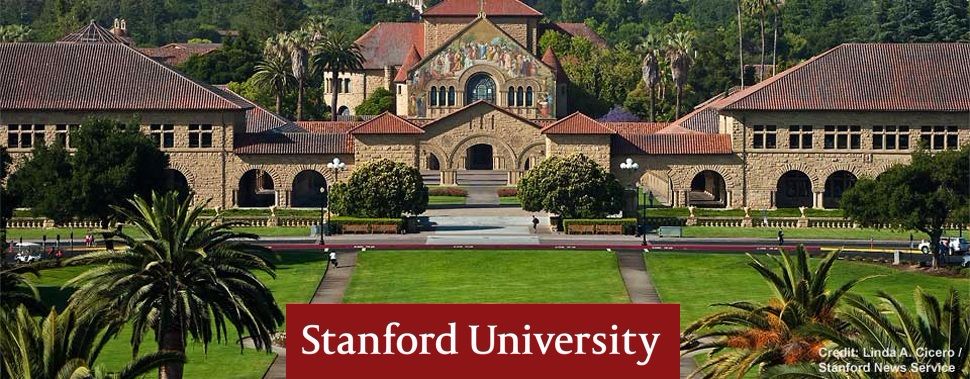
Il y a vingt ans, un comité présidé par sir Adrian Cadbury était institué en Grande Bretagne pour définir les conditions dans lesquelles le conseil d’administration pouvait s’acquitter efficacement de sa mission de contrôle.
Dix huit mois plus tard ces travaux déboucheront sur le fameux rapport Cadbury, premier d’une longue série : il existe aujourd’hui plus de 150 codes nationaux dont les recommandations ne sont pas très différentes de celles que l’on trouve dans le code anglais. Cette grande convergence des pratiques a été largement encouragée par la globalisation financière, l’influence des fonds d’investissement anglo-saxons et des agences de notation spécialisées dans la gouvernance.
Cependant, force est de constater que ces « bonnes pratiques » ne sont pas parvenues à empêcher les crises ou les scandales. Régulièrement mise en accusation, elles font l’objet de réglementations ou de recommandations toujours plus précises et fermes avant de très vite se révéler insuffisantes ou inopérantes. Ne serait-il pas temps de s’interroger sur les raisons de cette incapacité à mettre en place un système qui marche durablement?
« Corporate Governance Matters » (voir Vidéo) apporte des éléments de réponse à cette question. Destiné aux praticiens et écrit par deux professeurs de Stanford (David Larcker et Brian Tayan), ce livre présente systématiquement les coûts et bénéfices des différents mécanismes de la gouvernance à la lumière de la recherche académique ou des enquêtes professionnelles.
La lecture de cet ouvrage permet de constater que les pratiques que nous considérons comme essentielles n’ont en réalité qu’un lien très ténu (quand il n’est pas négatif) avec les performances opérationnelles ou actionnariales de l’entreprise.
La séparation des fonctions du Président et du Directeur général, l’indépendance des administrateurs ou du comité d’audit, la présence de représentants d’actionnaires salariés, la féminisation des conseils, le recrutement externe des dirigeants, les incitations alignées sur la performance actionnariale de l’entreprise, la rotation des auditeurs : autant d’exemples de fausses bonnes idées si l’on se réfère à la recherche académique.
Les enquêtes qui ont été menées sur le fonctionnement des conseils, la façon dont ils s’acquittent de leur responsabilité en matière de contrôle, le recrutement des dirigeants, leurs rémunérations montrent certes des progrès, mais aussi des carences et des frustrations importantes dont les administrateurs ont bien conscience, mais qu’ils semblent incapables de redresser.
Ce constat pessimiste ne doit pas nous conduire à abandonner tout espoir, mais il nous incite à réfléchir à la façon dont nous devons repenser la gouvernance.
Tout d’abord, les auteurs nous invitent à reconnaître l’importance du contexte. Il faut abandonner l’idée que l’on puisse mettre en place des mécanismes de gouvernance standardisés car l’efficacité du système dépend de la nature de l’actionnariat, de la maturité de la firme, de son histoire et de ses relations avec les marchés financiers, de l’environnement juridique dans lequel elle évolue, etc … Il n’y a pas de « one size fits all ».
A titre d’exemple, un système de stock-options doit non seulement prendre en compte toute la structure de la rémunération, mais aussi bien d’autres facteurs : l’appétence au risque défini par le conseil, l’âge du dirigeant concerné, son ancienneté, l’importance de son investissement financier dans l’entreprise, de sa fortune personnelle, son attitude à l’égard de la prise de risque, l’existence d’un plan de succession sérieux. Il n’y a pas de formule miracle. C’est aux administrateurs de réfléchir à la meilleure solution en fonction du contexte. La complexité de cette tâche jette un doute sur l’intérêt de laisser les actionnaires s’exprimer sur le sujet et sur la capacité d’un conseil à régler la question en quelques heures de débat.
Deuxièmement, l’approche de la réglementation et des « bonnes pratiques » est inadaptée. La fonction (ou les objectifs) des mécanismes de gouvernance sont plus importants que leurs caractéristiques organiques. De fait, la logique du « comply or explain » (largement soutenue par le régulateur) et les approches mécaniques adoptées par les agences de proxy pour vérifier l’application des codes de bonne conduite ont conduit au « box ticking », solution de facilité qui privilégie l’apparence à la réalité.
La gestion des risques et la communication qui est faite sur ce sujet est un bon exemple de cette dérive. Les administrateurs devraient moins s’intéresser à l’organisation ou aux procédures de contrôle qu’à l’adéquation de la prise de risque avec la stratégie de l’entreprise. Au lieu d’être présentés dans une liste générique et artificielle, les risques devraient faire l’objet d’une information vivante et hiérarchisée qui permette aux investisseurs de mieux comprendre la résilience du modèle de développement de l’entreprise (voir les observations du FRC en la matière). Le consensus de place sur le rôle des comités d’audit tel qu’il s’exprime dans les recommandations de l’AMF de juillet 2010 est bien loin de cette vision qui nécessiterait selon l’ouvrage « a substantial increase in analytical skills and processes» de la part des administrateurs.
Enfin, l’approche résolument organisationnelle de l’ouvrage conduit ses auteurs à insister sur l’importance de quatre éléments centraux d’un système de gouvernance efficace :
- la structure organisationnelle (le caractère plus ou moins décentralisé de l’entreprise) ;
- la culture organisationnelle (attitudes et comportements à l’égard du risque, de la performance, de l’esprit d’équipe) ;
- la personnalité du CEO (style de leadership) ;
- les qualités des administrateurs (capacité d’engagement, force de caractère).
Ces problématiques sont trop périphériques dans les débats sur la gouvernance. Il est vrai qu’elles ne peuvent pas être facilement réduites à quelques recettes ou mesures standardisées. Elles sont pourtant au cœur des réussites ou des échecs de la gouvernance.
Réintégrer les aspects culturels et comportementaux dans la gouvernance est le grand défi des praticiens et des chercheurs. Comme dans bien d’autres domaines, le soft est plus important que le hard.
A lire aussi
SUIVEZ MOI SUR TWITTER (JF_REROLLE)


